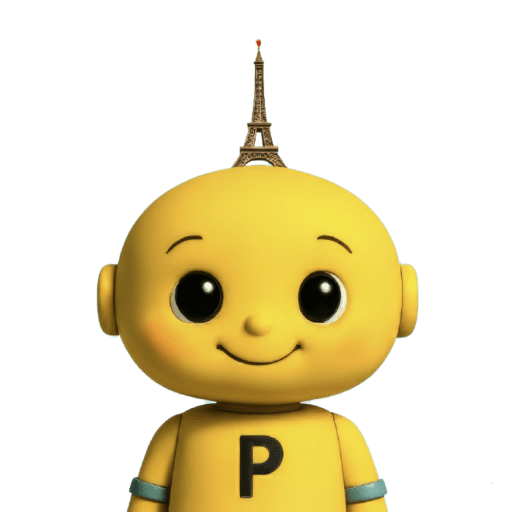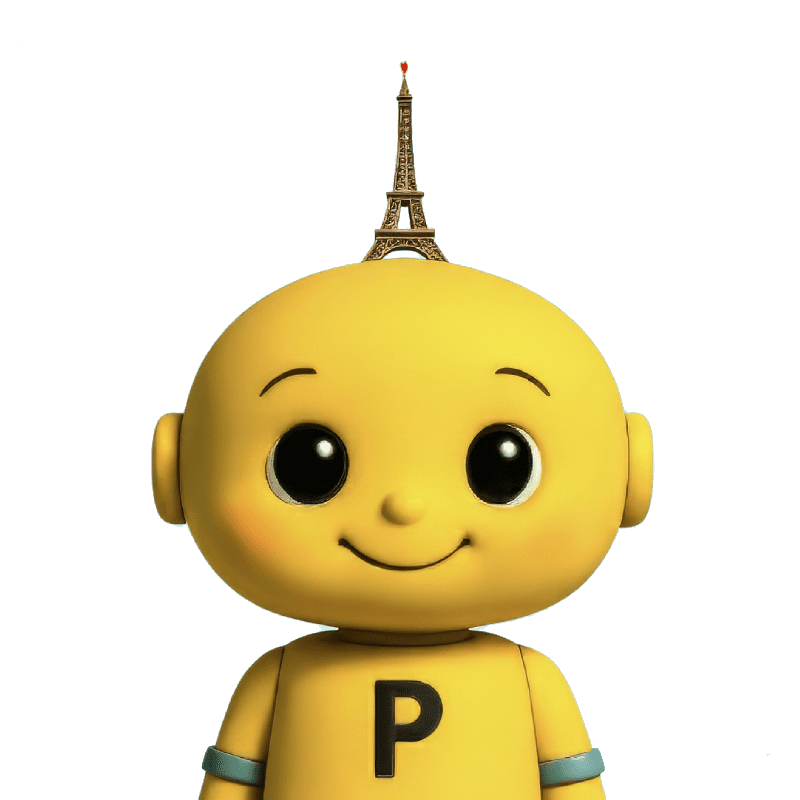Héritage dans un verre
Le jour où le saké est entré au panthéon de l’UNESCO
Le 5 décembre 2024, l’art pluriséculaire du brassage du saké au Japon, fondé sur le riz, l’eau et la puissance transformatrice du kōji, a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Dix ans plus tôt, c’était le washoku, la cuisine elle-même, qui recevait les honneurs. Alors, les plats tenaient la vedette. Cette fois, la lumière se pose sur la boisson qui achève la table.
Le double hommage dit beaucoup. Avec la cuisine reconnue en 2013 et le saké en 2024, la culture culinaire du Japon est saluée dans son intégralité. La petite coupe posée près du plateau laqué n’est plus un simple accessoire. Cuisine et saké forment ensemble un tout culturel, deux moitiés d’une même expression.
De l’exotisme express au choix du quotidien
La France a senti ce virage plus qu’ailleurs. Au début des années 2000, la rue Sainte-Anne, derrière l’Opéra, voyait défiler les amateurs de sushis et de ramen. Image rapide et exotique du Japon.
Puis une nouvelle génération de chefs a apporté les subtilités du dashi et de la fermentation. Le décor a changé. Quand l’UNESCO a salué le washoku, la cuisine japonaise faisait déjà partie du quotidien parisien.
Le tournant pour le saké
Le saké avançait à la traîne. Dans l’imaginaire français, il restait tiède, servi dans des tasses, difficile à décrire avec les mots du vin.
Tout bascule en 2017 avec Kura Master, concours parisien où des sommeliers dégustent le saké en verres à vin et le racontent avec un vocabulaire familier. Acidité. Arômes. Finale. Pour la première fois, le saké se laisse expliquer à un palais français.
Fêtes, riz local, eau locale
La même année, le Salon du Saké attire chaque automne des milliers de visiteurs. Plus de cinq mille aujourd’hui. Le rendez-vous est désormais inscrit dans le calendrier gourmand de la capitale.
En 2019, WAKAZE ouvre près de Paris. Riz cultivé en France. Eau locale. Un pas de plus. Le saké n’est plus seulement importé. Il se fabrique ici. Il prend la couleur d’un nouveau terroir.
Comment les Français choisissent leur saké
Dans une cave au Japon, on interroge rarement le vendeur sur la variété de riz ou le taux de polissage. En France, ces questions arrivent toutes seules.
Acheter du saké fonctionne un peu comme acheter du vin. On dit le plat prévu. On décrit ses préférences de nez et de bouche. On attend une recommandation solide. Le prix ne fait pas tout.
L’amateur regarde la variété de riz et la méthode de brassage, l’équivalent des cépages. Il regarde l’origine et l’histoire de la brasserie. Il regarde le profil gustatif, sec ou doux, aromatique ou discret. Il regarde la façon dont le saké dialoguera avec les mets.
Bref, on choisit le saké pour servir une histoire de table, pas comme boisson isolée. Pour les producteurs et les exportateurs, venir en France ne se limite pas à expédier des bouteilles. Il faut livrer un récit et une expérience. Relier le buveur au liquide, mais aussi au lieu, aux personnes et au savoir-faire.
Redécouvrir le saké à Paris
Du malentendu à l’authenticité
Aujourd’hui, trouver une boutique dédiée au saké n’a plus rien d’étrange. Dans certaines caves, des daiginjō et des junmai ginjō posent à côté des bourgognes et des bordeaux.
En flânant, on les repère en vitrine. Bouteilles fines. Étiquettes minimalistes. Contenu aussi net et raffiné que les vins voisins.
Cette mue est récente. Il n’y a pas si longtemps, on poussait la porte d’une épicerie asiatique et l’on croisait deux ou trois références. Souvent sans véritable conseil.
Des questions comme avec quels plats accorder, quelle différence entre ginjō et daiginjō, lequel se boit le plus facilement, finissaient parfois dans un haussement d’épaules poli. Pour beaucoup, le saké restait une énigme. Mystérieux. Pas simple à apprivoiser. Facile à éviter.
Quiproquo à table
Le mal vient d’un vieux contresens. Jusqu’au début des années 2000, nombre de petits restaurants dits japonais à Paris, souvent tenus par des propriétaires asiatiques non japonais, offraient en fin de repas un verre de « saké ».
Le plus souvent, c’était du baijiu chinois, une eau-de-vie puissante issue du riz ou du sorgho. Parfois un spiritueux sucré aux arômes ajoutés. Autour de quarante pour cent d’alcool. Nez qui claque. Brûlure immédiate. À mille lieues de l’équilibre d’umami et de la douceur du riz qui définissent le vrai saké.
Pour beaucoup de Parisiens, ce fut la première, parfois la seule rencontre avec le « saké japonais ». D’où une idée tenace et fausse. Le saké serait un digestif brûlant avalé en shooter après le repas, pas un compagnon de table.
Un premier verre de cet ersatz a suffi à ancrer la croyance. Il ne restait plus de place pour la subtilité, la douceur et les arômes feuilletés du saké authentique. La réputation du saké en France s’en est trouvée freinée pendant des années.
*Note utile. Le baijiu n’est pas inférieur. Il existe une grande diversité, y compris des flacons d’exception. C’est simplement un autre spiritueux. Fabrication différente. Manière de le boire différente.
Amener le vrai saké à la table française
Pendant longtemps, ce que l’on appelait « saké » en France relevait du malentendu collé au verre. Exotique. Puissant. Peu compatible avec la table.
La caricature pâlit à la fin des années 1990. Le sushi s’installe en ville. Le poisson cru n’étonne plus. Il devient chic. La curiosité ouvre la porte à la boisson qui manquait. Importateurs et brasseries japonaises sortent du périmètre Tokyo Kyoto. Paris offre une scène avide de nouveauté et attachée à la tradition.
En 2013, le Salon du Saké donne un vrai coup d’accélérateur. Rendez-vous annuel. Sommeliers et chefs français plongent dans la culture brassicole nippone. Le saké ne joue plus les seconds rôles. Il mène la danse. Servi et commenté avec la révérence d’un bourgogne. Des figures comme le sommelier Xavier Thuizat défendent sa finesse et en font un partenaire de gastronomie.
Les chefs français suivent, attentifs aux textures et aux nuances. Dans des cuisines étoilées, le saké s’invite auprès du foie gras, de la sole meunière, jusqu’aux desserts. Le vocabulaire du vin se glisse dans la conversation sur le riz et l’eau. Terroir. Minéralité. Millésime. Certaines brasseries explorent des cuvées pétillantes inspirées du Champagne. D’autres affirment des identités régionales, longtemps implicites au Japon.
Aujourd’hui, entrer dans une boutique parisienne dédiée au saké n’étonne plus. Les bouteilles s’alignent comme des grands crus. Étiquettes en kanji et en rōmaji. Provenance racontée avec la précision d’un chablis. Le Japon a officiellement demandé la reconnaissance du brassage traditionnel du saké au titre de patrimoine immatériel. Ce qui paraissait étranger et mal compris s’affiche désormais comme un trésor culturel.
L’arrivée du saké en France relève moins de l’invasion que de la révélation. Ce n’est plus une curiosité. C’est un miroir. Il reflète des siècles de savoir-faire japonais et l’envie française de réinventer la tradition à table.
Plonger dans le saké à Paris
L’intérieur du Salon du Saké
Chaque automne, un coin de Paris devient porte d’entrée vers la culture des boissons japonaises. Le Salon du Saké est le plus grand rendez-vous européen consacré au saké et aux boissons cousines. On y croise des brasseries, du shōchū, de l’umeshu, du thé vert, des wagashi, des artisans, même des idées de voyage.
Pendant trois jours, l’événement sert de vitrine vivante. Saveurs et traditions du Japon réunies en un même lieu.
Au-delà de la dégustation
Un espace pour comprendre
Tout le week-end, des conférences rassemblent sommeliers, spécialistes et maîtres brasseurs. Des masterclasses et des ateliers, souvent gratuits et parfois sur réservation, parcourent les styles régionaux, les techniques de brassage, les accords mets saké. Certaines séances payantes proposent des duos rares, par exemple wagashi et saké, dialogue délicat sur le palais.
Salon du Saké 2025
Dates et détails
L’édition 2025 se tient du samedi 4 au lundi 6 octobre au New Cap Event Center, en bord de Seine dans le 15e arrondissement. Plus de mille cinq cents mètres carrés d’exposition. Des brasseries venues de tout le Japon. Des importateurs. Des producteurs du monde entier. Plus de six cents références de sakés et produits associés.
L’an dernier, environ six mille visiteurs et une cinquantaine d’exposants. Beaucoup basés en France. D’autres venus du Japon, d’Europe et d’ailleurs. Preuve supplémentaire que le saké a quitté la niche pour s’installer durablement sur la scène européenne.
Billets et accès
Grand public. Samedi et dimanche.
Vente en ligne ou sur place.
Professionnels. Lundi. Accès gratuit sur présentation d’un justificatif.
- Pass 1 jour: €25
- Pass 2 jours: €40
Où acheter du saké à Paris
Ces dernières années, Paris a tissé un réseau discret de boutiques et de concept stores dédiés au saké. Les habitants comme les voyageurs repartent volontiers avec une bouteille pour un dîner simple ou un accord plus ambitieux. Quatre adresses se détachent, chacune avec sa propre vision de la culture du saké.
Maison du Saké, 11 rue Tiquetonne, 2e
Incontournable pour les passionnés. Rayons fournis en bouteilles rares venues de tout le Japon, dont Dassai, Yamaguchi, et l’insaisissable Juyondai, Yamagata. L’équipe guide aussi bien les débutants que les connaisseurs. Un bar attenant propose des vols de dégustation.
Site: lamaisondusake.com
Workshop Issé, 11 rue Saint-Augustin, 2e
À la fois boutique et lieu culturel. Sakés, mais aussi condiments artisanaux et produits d’épicerie fine. Un petit restaurant sert le midi avec accords saké, et des cours réguliers initient au brassage et aux accords.
Site: workshop-isse.fr
Irasshai, 40 rue du Louvre, 1er
Concept store contemporain. De labels haut de gamme jusqu’aux bouteilles du quotidien. Dégustations informelles pour les visiteurs. Emballages soignés qui en font une adresse appréciée des touristes comme des habitués.
Site: irasshai.co
Wakaze, 31 rue de la Parcheminerie, 5e
Pionnier du Made in France. Saké brassé à partir de riz de Camargue. Depuis 2022, sa première adresse parisienne de style izakaya fait entrer le saké dans le quotidien. Accords avec petites assiettes dans une ambiance détendue.
Site: wakaze-sake.com
J’aime les restaurants japonais à l’étranger. N’importe quel pays. N’importe quelle ville. Quand le patron est japonais, on sent les années passées au Japon, et celles passées ici, dans le pays qui l’a accueilli. Tout remonte à la surface, dans la saveur d’un bouillon, dans le bois fatigué du comptoir, dans les affiches et les cartes postales dont les couleurs ont passé. C’est une mémoire discrète, à peine murmurée, qui parfume la salle autant que la cuisine. Quand le patron n’est pas japonais, c’est une autre curiosité. Elle arrive sur l’assiette. On cuisine le Japon que l’on a dans la tête. Parfois cela tombe juste et l’on acquiesce. Parfois cela manque sa cible et touche autre chose, et l’on continue de manger, parce que c’est bon à sa manière.
À Londres ou à Paris, j’ai souvent eu l’impression qu’on pouvait commander un kit premier prix pour ouvrir un restaurant japonais. On ouvre la boîte et tout y est. Un chat qui salue, poignet joyeux pour l’éternité. Une guirlande de fleurs de cerisier en soie qui ne fanera jamais. Une affiche de bière avec une femme en kimono qui sourit. Le même menu plastifié et brillant. Une pile de bols en plastique prêts pour la guerre.
Je me suis toujours demandé pourquoi tant de propriétaires non japonais baptisent leur maison d’après une préfecture. Peut-être que le kit le suggère. Tokyo, Osaka, Kyoto bien sûr. Mais aussi Hokkaidō, Nagano, Shizuoka, jusqu’à Akita. Qu’est-ce qui les a fait choisir celle-là. Un ami a dit un jour. Il a peut-être fermé les yeux, posé le doigt sur une carte du Japon, et ce fut la bonne.
Mon premier sushi à Paris m’a coupé les jambes. Au Japon le riz s’assaisonne au vinaigre. Ici, le riz acide effrayait. On l’avait retiré. Une belle tranche de poisson cru posée sur une boule de riz nature. La soupe miso racontait la même histoire. Pas de dashi. Pas de bouillon d’algue et de bonite. Seulement de la pâte de miso et des champignons qui flottent dans l’eau chaude. Les yakitori avaient un filet de fromage. La sauce soja tirait sur le sucré. On fouillait le plateau sans retrouver le goût de la maison.
Près de mon bureau il y avait un Hokkaidō. Le même moule. Les jours où nous voulions du simple, plus léger qu’une pizza, nous y glissions pour le déjeuner. Parfois pour le dîner. Ce n’était pas pour la saveur. Les sushis et les yakitori arrivaient toujours un peu à côté. Un manque ici. Un surplus là. Personne ne commentait. Chacun portait ce visage de gens persuadés que la cuisine japonaise fait du bien au corps. Alors pour le reste on ferait avec.
Le repas se terminait par une petite cérémonie. Un dé à coudre de « saké » offert. Mon collègue français répétait son refrain. Le bon remède a mauvais goût. Cette gorgée aide à digérer. Allez, cul sec. Le seul Japonais à table ne pouvait pas laisser passer. Ce n’est pas du saké. Le vrai a la douceur de force d’un vin. Ce n’est pas une potion d’après-repas. On le savoure avec ce que l’on mange. Mes collègues n’avaient jamais goûté le vrai saké. Ils ne comptaient pas s’y mettre. Un hochement de tête. Un petit heu poli. Les manteaux sur le bras. Retour au travail.
Pendant ce temps la cuisine japonaise à Paris avançait à pas feutrés. Des chefs sans esbroufe. Ils choisissaient les produits français avec soin. Ils les transformaient en plats précis et beaux. De quoi surprendre ceux qui aimaient déjà le washoku au pays. De quoi intriguer le curieux qui s’assoit pour la première fois. Une assiette après l’autre, ils ont apprivoisé un petit noyau de fidèles français. Bientôt la ville s’est remplie de lieux vrais. Des comptoirs où l’on ne fait que du sushi. De vrais spécialistes de kushiage. Des maisons de ramen de référence venues du Japon ouvrir une antenne. Des bars à gyoza qui ont pris racine vite fait.
Le mouvement a pris de la vitesse en octobre 2006. Un petit groupe franco-japonais, une association privée, a mis au point un système de recommandation pour signaler l’authentique. Le 16 janvier 2007, cinquante restaurants ont été nommés et une pastille discrète est apparue sur les portes. L’ambassade du Japon à Paris observait l’affaire et a aidé à diffuser un guide via les consulats. On pouvait savoir avant de s’asseoir.
Paris tenait enfin l’ossature d’une vraie culture japonaise à table. Il restait la touche finale. La boisson. Le saké. La suite dira comment il est passé de curiosité à crédentiel. Comment il a gagné la confiance des chefs étoilés.