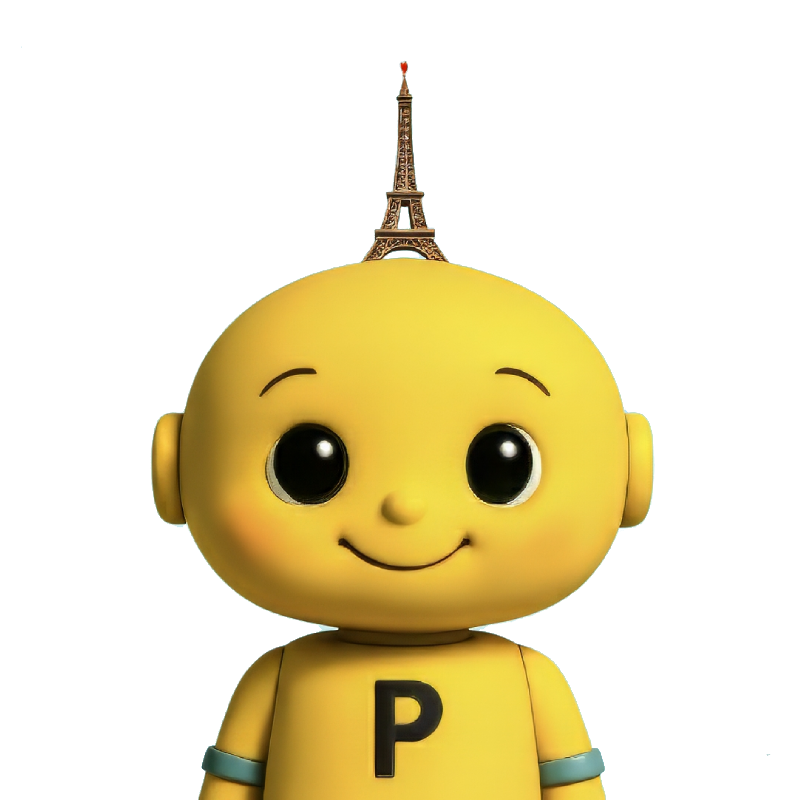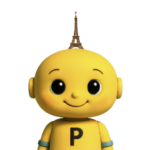Pas seulement pour les sushis. L’aventure mondiale du saké
Pourquoi lisez-vous ce texte ? Peut-être aimez-vous déjà le saké. Peut-être cherchez-vous encore à comprendre ce que c’est. Dans tous les cas, bienvenue.
Il n’y a pas si longtemps, l’idée de manger du poisson cru suffisait à vider une salle en quelques secondes. « Du poisson cru ? Vous plaisantez » était la réaction spontanée de nombreux convives occidentaux. Quelques décennies plus tard, le sushi est aussi familier que la pizza ou les tacos. On en trouve dans les galeries commerciales de banlieue, aux comptoirs des aéroports et dans les restaurants étoilés. Une tranche de thon brillante ne surprend plus personne.
Qu’est-ce qui a changé ? La curiosité a peu à peu remplacé la méfiance. Les mangeurs aventureux ont ouvert la voie. Les chefs japonais à l’étranger ont persévéré avec discrétion puis avec éclat, prouvant que le sushi peut être à la fois un déjeuner quotidien et un art raffiné. La cuisine japonaise n’est plus une curiosité exotique. Elle fait partie du paysage gastronomique international. Le sushi, autrefois déroutant, est devenu un plat de réconfort.
Le saké raconte une autre histoire. Hors du Japon, il reste souvent mystérieux, cantonné à l’idée qu’il n’est que la boisson qui accompagne les sushis. On l’imagine dans une petite tasse, parfois chaud, parfois froid, et la compréhension s’arrête là.
La réalité est bien plus intéressante. Le saké possède l’ampleur et les nuances du vin. Il peut être floral, terrien, vif ou soyeux. Il peut élever une assiette d’huîtres avec la grâce d’un champagne ou approfondir la richesse des viandes rôties d’une manière qui rappelle la Bourgogne. C’est un monde de saveurs à découvert.
Considérez-le comme une aventure. Découvrir le saké, c’est entrer dans une tradition séculaire qui se réinvente pour la table contemporaine. Prenez ceci comme une invitation à goûter, à poser des questions et à vous laisser surprendre. Les meilleurs voyages, en cuisine comme ailleurs, naissent de la curiosité.
L’histoire du saké au Japon
Une offrande sacrée (du IIIe siècle av. J.-C. au VIIIe siècle apr. J.-C.)
L’histoire commence dès le IIIe siècle avant notre ère. Les premiers brasseurs faisaient du kuchikamizake en mâchant le riz ; la salive transformait l’amidon en sucre, puis la bouillie fermait d’elle-même. Le saké n’était pas une boisson du quotidien. C’était une offrande sacrée lors des rites et des fêtes.
À l’époque de Nara, de 710 à 794, la production se structure sous l’État ritsuryō. Le saké tient un rôle essentiel dans les cérémonies impériales et les rites bouddhiques.
Boisson de l’aristocratie, période de Heian (794 à 1185)
Dès le VIIIe siècle, la cour impériale institue le Sake no Tsukasa, un bureau chargé du brassage. Les aristocrates de Heian apprécient des styles doux et denses comme le shirozake et le nerizake. Le saké devient un plaisir raffiné des réunions poétiques et des fêtes saisonnières.
Innovation et diffusion plus large, de Kamakura à Muromachi (1185 à 1573)
Sous Kamakura, les brasseurs mettent au point le morohaku-zukuri, avec riz poli et kōji en abondance. On se rapproche alors du style moderne : la saveur s’affine, la qualité progresse et la production peut prendre de l’ampleur.
Pendant Muromachi, les villes grandissent et les brasseries liées aux temples se développent. Samouraïs et bourgeois fortunés adoptent le saké, qui sort des cercles de cour pour gagner toute la société.
La boisson du peuple, époque d’Edo (1603 à 1868)
Edo marque un premier âge d’or. La paix et l’urbanisation sous les Tokugawa font exploser la demande. Des centres comme Itami, Nada et Osaka expédient vers Edo le kudarizake, le saké « en aval », en grands volumes. Il devient à la fois un produit de base et un signe de statut.
Au début du XIXe siècle, Edo boit avec conviction. Le saké n’est plus réservé aux fêtes. C’est l’habitude des jours de semaine. Les marchands descendent les barils par la rivière. Après le travail, « un seul petit verre » devient une ponctuation à part entière. Les tavernes servent de tableaux d’affichage et de salles de débat où l’on échange les potins, où l’on peste contre les patrons et où l’on discute sans fin du sucré et du sec. Ce n’est pas une cérémonie. C’est un réflexe. Verser, boire, parler, recommencer.
Puis le sol se dérobe. Le shogunat s’efface, un État moderne s’installe. Les brasseries doivent s’adapter. De nouveaux impôts et des politiques céréalières changent la donne. Le système d’apprentissage cède la place à des guildes de tōji organisées. Les maîtres sécurisent le riz, gèrent l’offre et tiennent des comptes équilibrés pendant que l’État garde la main sur la caisse. Le progrès n’arrive pas en douceur ; les taxes mordent, l’erreur coûte cher. La technique se précise, l’ambition grandit et l’artisanat devient une industrie moderne.
Le débat national s’élargit. Ce qui fait un « bon » saké n’est plus un slogan ; on l’éprouve chaque soir au comptoir et dans les ruelles. Le goût porte la marque de son époque. Avant les réformes du milieu du siècle, le saké d’Edo est plus riche et plus doux que bien des styles d’aujourd’hui. Les brasseurs utilisent souvent moins d’eau dans la cuve, pratique appelée plus tard ju-mizu, qui donne plus de corps et une douceur feutrée où le riz et l’eau s’expriment dans un registre grave. Le sec s’imposera plus tard. À la fin d’Edo, c’est la rondeur qui domine.
Des avancées techniques comme le brassage hivernal uniquement, le kanzukuri, et le traitement thermique hi-ire stabilisent la qualité. Le saké devient largement accessible au peuple, servi dans les izakaya et les maisons de thé animés, et s’entrelace aux fêtes, aux quartiers et à la vitalité de l’ukiyo, le « monde flottant ».
La tradition rencontre la modernisation, ère Meiji (1868 à 1912)
La modernité s’impose. Les polisseuses de riz industrielles permettent un polissage plus fin et plus efficace, d’où des styles plus légers et plus raffinés pour un public de plus en plus urbain.
Les laboratoires d’État et les universités appliquent la science au brassage. Les travaux sur les levures, la maîtrise des températures et la stabilité de fermentation améliorent régularité et qualité. Le brassage quitte le seul registre artisanal pour s’appuyer sur la recherche.
L’État reconnaît le poids économique du saké et le taxe fortement. À la fin du XIXe siècle, ces taxes représentent une part importante des recettes publiques. À Tokyo et Osaka, les izakaya servent le saké avec des plats traditionnels et des mets occidentaux. Boire devient un marqueur de la vie urbaine moderne tout en restant lié aux rites. Mariages, Nouvel An et fêtes locales maintiennent le saké au cœur de la communauté.
Le saké à l’ère Taishō (1912 à 1926)
Le changement social s’accélère. Démocratie, culture urbaine et idées venues d’ailleurs prospèrent. La technologie progresse encore. Les polisseuses modernes autorisent des raffinements inimaginables auparavant. Les laboratoires de l’État et des universités encouragent des approches scientifiques pour les levures, la fermentation et le stockage. Un saké plus net, stable et régulier séduit une classe moyenne attentive à l’hygiène. Les médias de masse le célèbrent dans la littérature, la publicité et la chanson. Boire du saké dans un izakaya ou lors d’une réunion politique devient un signe de participation à une société plus ouverte.
Shōwa avant-guerre (1926 à 1945)
Le climat se durcit. Les troubles politiques et la militarisation gagnent. Les pénuries de riz approchent et l’État renforce son contrôle. Les brasseries doivent étirer les ressources. Le sanbai-zojōshu, saké « triple », ajoute alcool distillé et amidons de substitution pour compléter le riz. L’approvisionnement tient, mais le profil change ; le saké devient plus léger et moins nuancé.
Malgré tout, il demeure présent. Les soldats boivent une dernière coupe avant le départ. Les familles marquent les saisons et les étapes de la vie avec de petites quantités, même en temps de disette. À mesure que la guerre du Pacifique s’intensifie, le saké devient un bien strictement contrôlé. Il est dilué, rationné et adapté pour survivre, tout en gardant sa charge de réconfort et de mémoire.
Shōwa après-guerre (1945 aux années 1970)
Le Japon d’après-guerre est en ruine. Le brassage est limité et beaucoup de producteurs recourent à des styles dilués et fortifiés pour économiser le riz. La qualité en pâtit, mais la présence du saké assure une continuité.
Dans les années 1950, la reprise apporte de meilleures récoltes et des brasseries plus stables. Les progrès en réfrigération, stockage et sélection de levures redonnent au saké le niveau de finesse d’avant-guerre. Dans les années 1960, au cœur de la croissance rapide, il reprend sa place dans la vie sociale. Usines et bureaux fêtent les étapes avec des bouteilles. Mariages et fêtes saisonnières coulent à flots. Les salarymen en boivent dans des izakaya bondés, souvent aux côtés de la bière.
Les grands groupes dominent par la production de masse, tandis que les brasseries régionales préservent les styles locaux. Cet équilibre entre l’échelle et l’héritage prépare une renaissance ultérieure.
Le saké à l’époque moderne, des années 1970 à aujourd’hui
Au cours des années 1970, le Japon a achevé sa reconstruction et entre dans la prospérité. La vie quotidienne change avec la consommation, la technologie et les échanges culturels mondiaux. Le saké se trouve à la croisée des chemins.
Les styles premium ginjō et les jizake régionaux décollent. De petites brasseries proposent des profils distinctifs qui contrastent avec les grandes marques. Un polissage soigné et des levures spécifiques apportent des arômes élégants qui séduisent une nouvelle génération. La consommation par habitant atteint un sommet historique en 1973.
Le paysage évolue bientôt. La bière devient moins chère et les grands brasseurs conquièrent les jeunes par un marketing offensif. Au début des années 1980, les boissons prêtes à boire douces et peu alcoolisées progressent, de même que les cocktails et les vins importés. L’image du saké se rétrécit et s’associe aux hommes plus âgés.
Les années 1990 apportent la récession et les difficultés. De nombreuses petites brasseries ferment. La consommation intérieure baisse. Vient alors la réinvention. Inspirés par la scène gastronomique internationale, des producteurs misent sur la qualité plutôt que sur le volume et privilégient le junmai daiginjō et d’autres styles haut de gamme. Le saké se repositionne en compagnon raffiné de cuisines variées.
Dans les années 2000 et 2010, le saké trouve un nouveau souffle à l’étranger. À mesure que la cuisine japonaise gagne en prestige, on voit du saké sur les cartes de New York à Paris. Les sommeliers explorent sa polyvalence avec huîtres, foie gras et fromages autant qu’avec les plats japonais classiques. Des boutiques spécialisées ouvrent dans les grandes capitales. Les concours internationaux fixent de nouveaux standards.
Un jalon arrive en 2023 quand l’UNESCO reconnaît le saké comme élément du patrimoine culturel immatériel. Cette reconnaissance l’élève de tradition nationale à trésor partagé. Dans le même temps, les exportateurs et les brasseurs se tournent vers l’étranger pour faire face au vieillissement et au déclin démographique du Japon.
Aujourd’hui, le saké ne se limite pas aux comptoirs de sushi. Il se tient à côté du vin dans les salles étoilées, apparaît en vols de dégustation et s’offre avec élégance. Les brasseurs explorent le terroir en mettant en avant les variétés de riz, les sources d’eau et les souches de levure avec la précision attendue pour le vin. Les collaborations, qu’il s’agisse de bulles ou de projets avec du riz cultivé en France, montrent comment tradition et innovation prospèrent ensemble.
De l’allégresse des années 1970 aux épreuves de la récession, d’une boisson mal comprise d’hommes mûrs à un luxe mondial, le parcours du saké reflète le Japon contemporain. C’est une histoire de résilience, d’adaptation et de réinvention. Sa palette de saveurs parle autant de l’identité japonaise que de l’imagination des chefs et des amateurs partout dans le monde.
Le saké et l’évolution du paysage des boissons
Le XXe siècle est mouvementé. Les pénuries de guerre rendent courant le saké « triple » fortifié avec alcool ajouté et amidons de substitution. La bière reste un produit de luxe qui peut coûter près d’une demi-journée de salaire la grande bouteille, si bien que le saké demeure le choix quotidien.
Les années 1970 marquent un nouveau sommet avec la diffusion des ginjō et des jizake dans tout le pays. En 1973, la consommation par habitant atteint un record. Puis le prix de la bière baisse, la publicité se fait plus insistante et des boissons douces et peu alcoolisées comme Horoyoi de Suntory trouvent leur public au début des années 1980. Les cocktails et le vin s’imposent dans les villes et l’image du saké vieillit.
Réinvention pour la table mondiale
Les jeunes boivent moins et la population vieillit. Les ventes domestiques reculent. À l’étranger, le tableau est différent. Avec le prestige croissant de la cuisine japonaise au XXIe siècle, le saké monte sur de nouvelles scènes. Les exportations progressent et la reconnaissance de l’UNESCO en 2023 confirme sa valeur culturelle.
Désormais, le saké est chez lui bien au-delà des bars à sushi. Il s’installe sans effort à côté du vin dans la haute cuisine, s’accorde avec des classiques français et une gastronomie moderne de façon à surprendre même les sommeliers aguerris. La précision et le soin de son élaboration, souvent au sein de brasseries familiales plusieurs fois centenaires, le rendent aussi à sa place dans un coffret cadeau que dans un menu dégustation ambitieux.
Ce qui fut d’abord une offrande sacrée puis une boisson humble du quotidien renaît comme un luxe mondial. La diversité de ses styles attend l’imagination des chefs et la curiosité des amateurs partout.
L’ascension du saké a quelque chose de stupéfiant. Je l’ai toujours aimé, mais je n’en suis vraiment tombé amoureux qu’après mon arrivée en France. Au Japon, mon rituel tenait à peu de choses. J’entrais dans un *soba-ya, je commandais de *l’itawasa, ce gâteau de poisson avec du wasabi, et je buvais ce qu’on me servait. Je ne demandais jamais la marque. Personne ne le faisait. Si on le voulait frais, on disait hiya. Si on le voulait chaud, on disait atsukan. L’éventail des choix se limitait à cela.
À l’époque, s’enquérir des étiquettes passait pour de la frime. Aujourd’hui encore, je ne m’obsède pas à savoir si la bouteille porte la mention junmai daiginjo ou simplement ginjo. Sur le papier, la différence est nette, l’un n’a pas d’alcool ajouté, l’autre oui. Dans le verre, le scénario n’est pas toujours respecté. Il arrive que le plus simple des junmai exprime le mieux la voix de la maison, régulière, honnête, impossible à confondre.
Ce que je préfère, c’est l’expérience. Même brasserie, même riz, polissage différent. C’est là que l’image se met au point. Une bouteille envoie des notes de lys et de pêche blanche sur la langue. Une autre reste silencieuse et fraîche, purement céréalière, avec un léger bourdonnement d’umami qui rapproche les mets. Aucune n’est supérieure à l’autre. Le polissage ne fait que réorganiser le mobilier. Abaissez le taux de polissage de quelques points et la pièce change, l’odeur, la lumière, jusqu’à la manière de parler.
Le moyen le plus simple de découvrir son propre style consiste à commencer par Dassai. La maison rend la lecture limpide, même étiquette, niveaux de polissage différents. Alignez les bouteilles et servez-les côte à côte. Vous saurez vite quel degré de polissage vous convient. Ensuite, choisir parmi les autres brasseries devient bien moins intimidant.
*Soba Les soba sont de fines nouilles à base de sarrasin (souvent mêlé à du blé). On les mange chaudes dans un bouillon ou froides sur un plateau en bambou (zaru soba) avec une sauce à tremper appelée tsuyu, faite de sauce soja, dashi et mirin. Garnitures courantes : cébette, nori, wasabi râpé, tempura, daikon râpé. Les soba sont appréciées pour leur goût de noisette et leur finale légère ; froides en été, chaudes en hiver.
*L’itawasa L’Itawasa est un hors-d’œuvre composé de tranches de kamaboko (pâté de poisson cuit à la vapeur) servies sur une petite planche ou une assiette, avec un peu de wasabi frais et parfois de la sauce soja. Le nom vient de ita (planche) et wasabi. On savoure la texture ferme et élastique du kamaboko et son umami délicat relevé par le piquant du wasabi, souvent en accompagnement du saké.