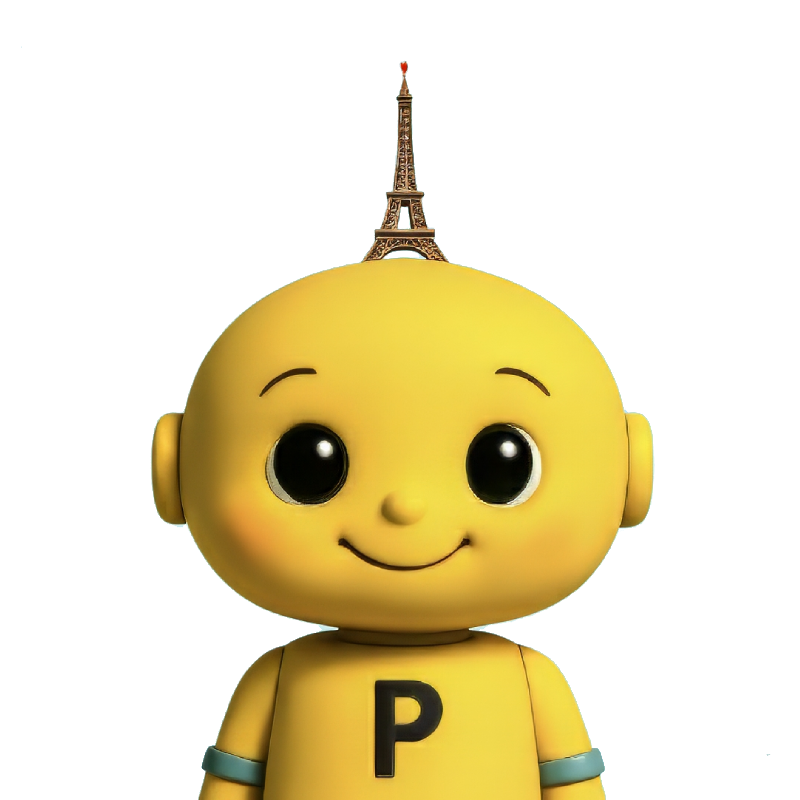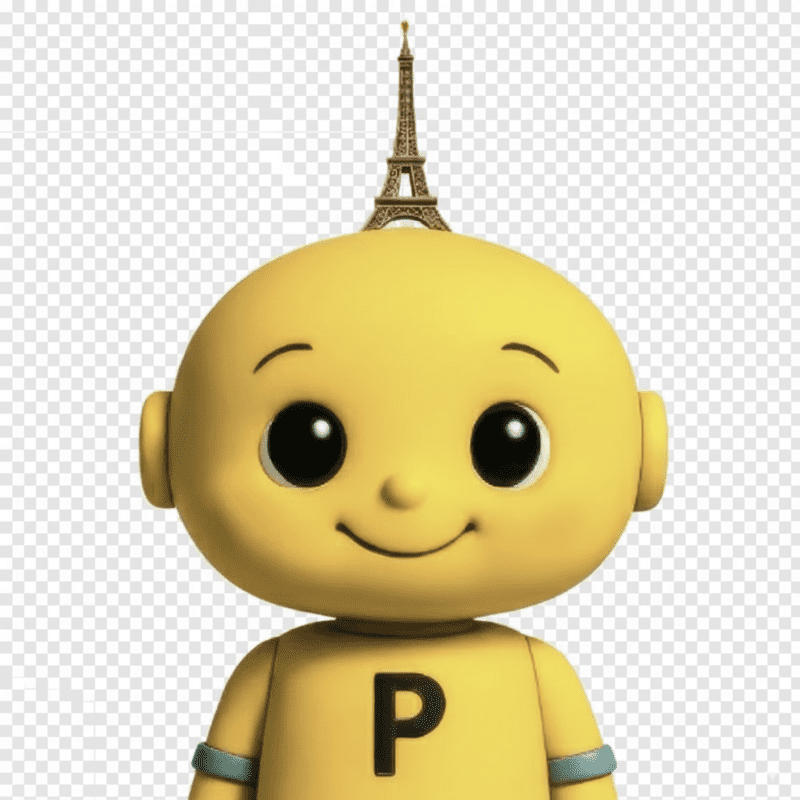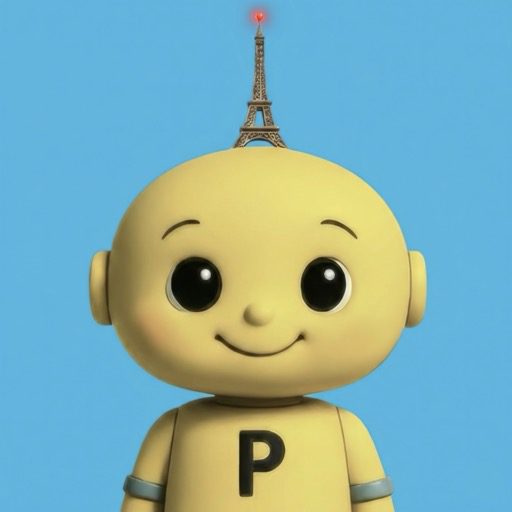Les vendanges arrivent plus tôt
Les vendanges avancent. À Beaune, où un registre remonte à 1659, les dates ont peu varié pendant des siècles. Puis est venue l’année 1988. Depuis, à mesure que le réchauffement s’accélère, le début des récoltes s’est déplacé d’environ seize jours en moyenne. La chaleur presse tout. Débourrement, floraison, maturité. Le sucre monte, l’alcool suit, l’acidité baisse. Les vignerons tentent de reprendre la main en cueillant plus tôt, mais la marge est limitée. En 2019, une vague de chaleur dans le Sud a brûlé feuilles et grappes. Dans certaines zones du Gard et de l’Hérault, la moitié de la récolte a été perdue.
Été 2025, un pays partagé
L’été 2025 a tracé une frontière sur la carte. De juin à la mi-août, la France a connu son troisième été le plus chaud. Le Nord s’est presque senti favorisé. En Loire, en Bourgogne et en Champagne, les raisins ont mûri pleinement sans recourir à la chaptalisation. Les vins sont sortis plus ronds, plus autonomes. Le Sud a raconté une autre histoire. Le degré moyen est passé d’environ 11,8 % dans les années 1980 à près de 14 % aujourd’hui. L’acidité s’érode, les saveurs s’alourdissent. Le marché penche vers la fraîcheur. Les producteurs du Sud se retrouvent en décalage.
Le sucre, force et menace
Le sucre donne au vin sa matière et son élan. En excès, il fait basculer l’équilibre. Une étude au long cours en Languedoc a montré une hausse de plus de deux points du potentiel alcoolique et une baisse d’un gramme par litre de l’acidité totale. Le défi consiste désormais à conserver un dessin net tout en freinant la montée du sucre. Le goût change aussi avec la météo. Les étés plus chauds amènent des repas plus légers, des plats plus frais et, avec eux, une envie de vins plus légers. La consommation mondiale a atteint en 2024 son plus bas niveau depuis soixante ans. La filière doit résoudre une équation. Produire des vins plus frais et plus abordables, capables de tenir sous la chaleur.
Au-delà du climat, les marchés
La pression n’est pas seulement climatique. La consommation intérieure recule en France. Aux États-Unis, un droit de douane de 15 % sur les vins européens ajoute une charge de plus. Des aides publiques indemnisent l’arrachage, mais beaucoup estiment que l’argent ne suffira pas à assurer l’avenir. Le coût humain augmente. Le travail de la vigne compte parmi les métiers les plus exposés au stress thermique, juste derrière le bâtiment. Une enquête indique que près de la moitié des salariés du vin en France envisagent de quitter le secteur d’ici cinq ans. Des vendanges longues sous quarante degrés éprouvent corps et esprit. En Alsace, le village d’Eguisheim a enregistré en 2025 sa vendange la plus précoce en deux siècles. L’acidité laissait espérer des vins de garde, mais les vignerons avouaient leur malaise. Quatre à cinq semaines de labeur sous une chaleur accablante constituent une crise à part entière. Un paysan confiait que sa génération pourrait bien être la dernière à vivre sereinement de la vigne en Alsace.
Cépages et stratégies en mouvement
L’adaptation redessine déjà le vignoble. Bordeaux s’éloigne du merlot au profit du cabernet-sauvignon et a officiellement approuvé six cépages complémentaires plus résistants à la chaleur. La Bourgogne ne peut renoncer au pinot noir. On joue donc sur les marges en ajustant les dates de récolte et la gestion du couvert végétal pour abriter les grappes. En Languedoc, on teste l’assyrtiko pour sa capacité à garder de la tension sous la chaleur, même si les règles d’appellation en limitent l’usage. Le tracé même des parcelles évolue. Des rangs nord-sud atténuent les brûlures d’après-midi. Toiles d’ombrage, couverts végétaux et paillage deviennent aussi indispensables que barriques et pressoirs. Le pilotage du vignoble ressemble de plus en plus à de l’architecture du paysage.
Les vignes vues d’en haut
Les satellites ont rejoint le métier. Sous la bannière de la viticulture de précision, les images de Sentinel-2 cartographient vigueur des ceps et stress hydrique. Ces vues orientent les choix. Irriguer tel coteau, vendanger tel îlot en premier. En Occitanie, des essais croisent capteurs au sol et images satellites et alimentent des logiciels qui dressent un portrait en temps quasi réel du stress hydrique, parcelle par parcelle. La tradition garde la main, mais l’intuition se vérifie désormais à l’échelle orbitale.
Ce qui attend la vigne
L’avenir ne se jouera pas sur la latitude seule. Le climat pousse la vigne vers le nord, mais les gagnants seront ceux qui décideront rang par rang. Tourner les ceps pour adoucir le soleil de l’après-midi. Protéger le sol avec de la paille ou des couverts pour garder l’humidité. Vendanger de nuit pour ménager les équipes. Introduire des cépages et des porte-greffes plus tolérants à la sécheresse. Proposer des cuvées plus légères, plus fraîches, moins alcoolisées. Deux siècles de carnets de vendanges manuscrits voisinent désormais avec des cartes satellites mises à jour semaine après semaine. Ensemble, ils racontent une évidence. Le goût du vin français devient l’archive non seulement d’un terroir, mais du climat qui change au-dessus de lui.
Gestes d’adaptation en bref
- Orienter les rangs pour adoucir l’ensoleillement.
- Couvrir le sol de paille ou de végétal pour retenir l’humidité.
- Vendanger de nuit pour épargner les travailleurs.
- Introduire des cépages et des porte-greffes résistants à la sécheresse.
- Offrir des cuvées plus légères, plus fraîches, moins alcoolisées.
Deux siècles de journaux de vendanges manuscrits côtoient aujourd’hui des cartes satellites en temps réel. Ensemble, ils tracent une vérité simple. Le goût du vin français devient un relevé vivant non seulement des sols et des pentes, mais du climat qui les surplombe et qui change.
J’ai vendangé une fois, quand j’étais étudiant. En France, il y a peu de petits boulots pour les étudiants. Les emplois à temps partiel qu’on trouve partout au Japon, cafés, boutiques, ici reviennent à des professionnels. Le serveur de café n’est pas un garçon de dix-neuf ans en nœud papillon, c’est un monsieur d’une cinquantaine d’années qui fait cela depuis toujours, vif sur ses jambes, fier de son métier. Les étudiants n’entrent pas dans ce rôle.
La vendange semblait donc le travail rêvé. Deux semaines dans les vignes, les repas et un lit pris en charge, en réalité un matelas à même le sol, et assez d’argent de côté pour continuer à voyager. Pour les étudiants étrangers, l’offre paraissait idéale. Les jeunes Français savaient mieux. Ils avaient vu le travail de près et n’en voulaient pas.
J’ai compris dès le premier jour. Au coucher du soleil, j’étais à bout, le corps en morceaux. On nous avait dit que nous pourrions boire autant de vin que nous voudrions, mais j’étais trop fatigué pour lever un verre. Chaque nuit je m’endormais comme si l’on m’avait lâché d’une grande hauteur. Les gens étaient gentils, j’en garde un bon souvenir, mais une fois m’a suffi.
À l’époque, les vendanges avaient lieu en automne. Les matinées étaient froides, les soirées plus froides encore. En journée on atteignait parfois vingt-cinq degrés, jamais davantage. Le soleil brûlait pourtant. On portait une armure, chapeau, manches longues, bottes. Les sarments griffent, des serpents et des insectes se cachent dans l’herbe. Et il y avait toujours la hotte en osier sanglée dans le dos, qui se remplissait jusqu’à vous faire chanceler sous le poids. Même dans l’air frais, on finissait trempé de sueur.
Aujourd’hui le travail s’est déplacé en plein été. Quarante degrés. Il faut l’imaginer, des vêtements lourds, une hotte pleine, la chaleur qui appuie de tout son poids. Au bout de deux heures on s’effondre. Ce n’est pas romantique, c’est dangereux. On parle de sélectionner des cépages capables de supporter la chaleur. Très bien. La vraie question est de savoir si les gens le peuvent. Je crois que non. Pas sans aide.
Les machines existent déjà pour faire ce travail. Des robots de vendange avec des mains assez délicates pour cueillir une grappe sans l’écraser, des capteurs assez fins pour lire la maturité mieux que l’œil humain. Certains protestent, les grands vins doivent être vendangés à la main. Comme si le jus pouvait le savoir. Comme si la romance l’emportait sur la survie. Ce n’est pas le cas. Pas ici. Il s’agit de protéger des vies.
Bien sûr, les petits exploitants n’ont pas les moyens d’acheter ces machines. C’est là que le bât blesse. Mais si des subventions doivent être dépensées, c’est là qu’elles devraient aller, protéger les travailleurs, maintenir les vignobles en vie. L’assurance maladie couvre les accidents, pourquoi ne pas financer les outils qui les évitent.
La chaleur ne va pas disparaître. Elle deviendra plus dure. Si l’on attend trop, on verra davantage de blessures, davantage de vignerons qui renoncent, des villages entiers qui perdent leurs vignes. Alors la romance mourra pour de bon.
Mieux vaut laisser un robot porter la charge que regarder les gens s’effacer.